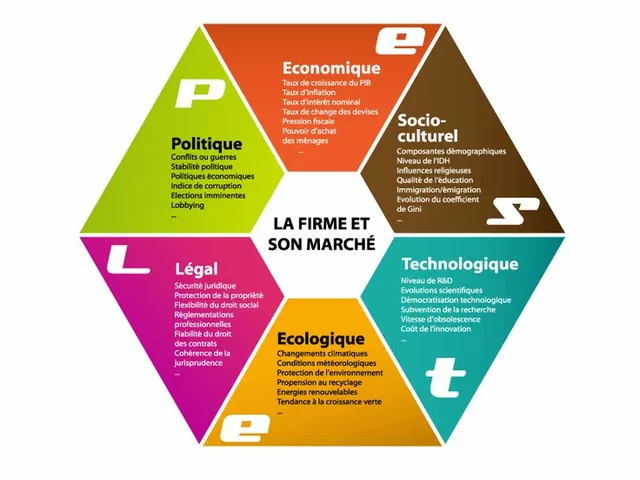Libéré après 140 jours de détention au Venezuela, le Français Camilo Castro rentra à Orly
Il a atterri à Orly sous une pluie fine, les yeux encore marqués par l’incertitude, mais le regard libre. Camilo Pierre Castro, 41 ans, professeur de yoga originaire de Toulouse, est rentré chez lui après 140 jours d’enfer. Arrêté le 26 juin 2025 au poste-frontière de Paraguachon, entre le Venezuela et la Colombie, il était accusé d’être un « terroriste de la CIA » — une allégation aussi absurde que cruelle. Ce dimanche 16 novembre 2025, vers 16h20 UTC, son avion a touché le sol français. Sans contrepartie. Sans échange. Juste la liberté, rendue par la pression diplomatique, la ténacité de sa famille, et la voix de la France.
Un voyage banal qui a tourné au cauchemar
Camilo Castro vivait en Colombie depuis plusieurs années. Il avait choisi cette terre pour sa douceur, ses montagnes, sa communauté de yogis. Le 26 juin, il n’était qu’un homme ordinaire, en route pour renouveler son visa de séjour. Selon sa famille et Amnesty International, il s’était rendu au Venezuela uniquement pour faire tamponner son passeport — une formalité courante pour les résidents transfrontaliers. Rien de plus. Rien qui justifie une arrestation. Pourtant, les autorités vénézuéliennes l’ont détenu sans mandat, sans accusation formelle, sans accès à un avocat. La confirmation de sa détention n’est arrivée à ses proches que le 19 juillet, après que des Américains libérés dans un échange de prisonniers ont affirmé l’avoir croisé dans la prison d’El Rodeo, près de Caracas.Une cellule, deux repas, une heure de yoga
Les conditions étaient désastreuses. Sa mère, Hélène Boursier, et son beau-père ont décrit, dans des entretiens avec Amnesty International, une cellule surpeuplée, une hygiène précaire, une alimentation insuffisante. Mais Camilo a survécu. Comment ? Par le yoga. Chaque jour, il avait droit à une heure de sortie. Il la passait à étirer son corps, à respirer, à méditer. C’était sa seule arme contre la folie. « Il nous disait qu’il sentait encore les montagnes de la Colombie dans ses os », raconte Hélène. Il n’a jamais perdu la foi — ni la dignité. Même quand on lui a dit qu’il était un espion. Même quand les murs ont commencé à lui parler.La diplomatie française en action
Le président Emmanuel Macron a annoncé sa libération en direct sur X, le 16 novembre au matin. « Camilo Castro est libre. Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont œuvré à sa libération. » Une déclaration rare. Directe. Personnelle. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a confirmé à la radio que « rien n’a été échangé ». Aucun détenu vénézuélien libéré en échange. Aucun accord commercial. Aucune concession politique. « Ce n’était pas une transaction. C’était un droit », a-t-il martelé sur franceinfo. Et pourtant, les faits parlent d’autre chose. Le Venezuela est connu pour sa « diplomatie des otages », comme l’Iran. Depuis la réélection contestée de Nicolás Maduro, des dizaines d’étrangers — dont des Français, des Espagnols, des Américains — ont été arrêtés pour servir de levier de négociation. Amnesty International a documenté cette stratégie dans un rapport de mi-juillet : « Les autorités utilisent les disparitions forcées pour justifier des conspirations étrangères et négocier des avantages. »Un cas qui résonne plus loin
Le dossier de Camilo n’était pas isolé. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken l’avait cité publiquement, liant son cas à celui d’autres détenus. Et c’est là que la diplomatie française a joué sa carte la plus fine : elle a travaillé en coulisses, sans fanfare. Jean-Noël Barrot s’est rendu au Mexique et en Colombie pour un sommet régional, où il a fait du cas de Camilo une priorité. Le Brésil, la Colombie, le Mexique — tous ont appliqué une pression discrète mais constante. Ce n’était pas un miracle. C’était du travail. De la patience. Et une volonté de ne pas céder au chantage.Libéré, mais pas guéri
À son arrivée à Orly, Camilo Castro n’a pas crié. Il n’a pas souri. Il a simplement dit, d’une voix calme, devant les caméras : « Vive la liberté, vive l’égalité, vive la solidarité. Puissent tous les êtres sur cette terre vivre hors de toute souffrance. » Ces mots, simples et profonds, ne sont pas un discours. C’est un cri du cœur. Il a survécu. Mais il n’est pas encore chez lui. Les cicatrices psychologiques, elles, ne s’effacent pas avec un vol en avion. Son corps a retrouvé la France. Son esprit, lui, doit encore traverser la nuit.Le Venezuela, un pays qui retient les hommes pour négocier
Depuis 2018, plus d’une trentaine de ressortissants étrangers ont été arrêtés au Venezuela dans des circonstances similaires. Certains ont été libérés après des mois, voire des années. D’autres, comme le journaliste espagnol José Antonio Espinosa, sont morts en détention. Le régime de Maduro n’a jamais reconnu officiellement sa politique d’otages. Mais les faits sont là : les arrestations surviennent souvent après des tensions diplomatiques. Les libérations, toujours après des concessions. Camilo est l’un des rares à être revenu sans que rien ne soit cédé. Une exception. Un espoir. Et une preuve que la pression internationale, bien menée, peut briser les chaînes.Frequently Asked Questions
Pourquoi Camilo Castro a-t-il été arrêté au Venezuela ?
Camilo Castro a été arrêté alors qu’il se rendait au Venezuela uniquement pour faire tamponner son passeport, une formalité courante pour les résidents transfrontaliers entre la Colombie et le Venezuela. Les autorités vénézuéliennes l’ont accusé à tort d’être un « terroriste de la CIA », une allégation démentie par le ministère français des Affaires étrangères. Son arrestation s’inscrit dans une stratégie plus large de « disparitions forcées » utilisée par le régime de Maduro pour négocier avec d’autres pays.
Comment la France a-t-elle obtenu sa libération ?
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a mené des négociations discrètes avec les pays voisins — Mexique, Colombie, Brésil — lors d’un sommet régional. La pression diplomatique, combinée à la visibilité médiatique et à la campagne d’Amnesty International, a contraint le Venezuela à libérer Castro sans contrepartie. C’est une rare victoire : habituellement, les libérations exigent des échanges de prisonniers ou des concessions politiques.
Quelles étaient les conditions de détention de Camilo Castro ?
Emprisonné à El Rodeo, près de Caracas, il partageait une cellule avec un autre détenu, recevait deux repas par jour et bénéficiait d’une heure de sortie quotidienne. Selon sa famille, les conditions sanitaires étaient précaires, mais il a survécu grâce à sa pratique du yoga, qu’il effectuait chaque jour pendant son heure d’air. Ces détails ont été confirmés par Amnesty International, qui a dénoncé les conditions inhumaines dans les prisons vénézuéliennes.
Pourquoi ce cas est-il différent des autres otages vénézuéliens ?
Contrairement à la plupart des libérations de ressortissants étrangers au Venezuela, celle de Camilo Castro n’a pas été suivie d’un échange ou d’une concession politique. Le gouvernement français a refusé toute contrepartie, affirmant que sa libération était un droit fondamental. Cette position, inédite, pourrait ouvrir la voie à une nouvelle stratégie diplomatique contre la « diplomatie des otages ».
Quel est le rôle d’Amnesty International dans cette affaire ?
Amnesty International a été l’une des premières organisations à documenter la détention de Camilo Castro, en publiant un rapport en juillet 2025 qui dénonçait les « disparitions forcées » systématiques au Venezuela. L’ONG a relayé les témoignages de sa famille, mis en lumière les conditions de détention et pressé les gouvernements occidentaux d’agir. Son travail a permis de maintenir l’affaire dans l’actualité internationale, ce qui a forcé le Venezuela à réagir.
Quelles sont les chances qu’un autre Français soit détenu au Venezuela aujourd’hui ?
Il n’existe pas de chiffre officiel, mais plusieurs sources diplomatiques confirment que d’autres ressortissants européens sont toujours détenus dans des conditions similaires. Le Venezuela continue d’utiliser les arrestations arbitraires comme levier de négociation. La libération de Camilo ne signifie pas la fin de cette pratique — mais elle montre qu’une pression coordonnée peut faire céder le régime.